Poignant témoignage de l’instinct féminin face à la folie des hommes : la douleur d’une jeune femme, qui perd son promis à la guerre, se mue en une profonde écoute de soi en parfaite entente avec les autres femmes du village. Une économie de mots qui se passe de commentaires…
En 1919, l’auteur ( 1835 – 1925 ) prit les dispositions nécessaires pour que son témoignage ne fût pas ouvert avant 1952, par l’aînée de ses descendants et seulement si elle avait entre 15 et 30 ans. Cette fourchette a son importance, car à cet âge une personne suit encore ses instincts, et n’est pas entièrement prisonnière des préjugés sociaux. Dans la préface qu’elle adjoignit en juin 1919, l’auteur résume la situation en quelques mots très simples : « j’avais 16 ans en 1851, 35 ans 1870 et 84 aujourd’hui. A chaque fois, la République nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C’était un travail propre. Mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, n’ont plus donné de récolte. A tant faucher les hommes, c’est la semence qui a manqué (p.3) ».
Pour appuyer son coup d’Etat, Napoléon III avait violemment réprimé le soulèvement républicain avec le sang de jeunes hommes enrôlés de force, pour une cause qui leur était étrangère. Le futur mari de Voilette, Martin, fut de ceux-là, peu après qu’elle eût réussi à s’en faire aimer… Mais c’était sans compter avec le malheur : « moi, après ces jours de cris et de pleurs, j’avais transformé ma douleur en haine et en violence […] Mon cœur est toujours sans fruit. Mon cœur et mon corps sont vides. Le premier pleure l’homme perdu. Le second l’homme qui ne vient pas. Depuis deux ans, je crie ma révolte de jeune femme saccagée par l’enlèvement de son promis, au moment où il allait la faire femme et la mère. Depuis deux ans, la douleur me remplit et me sert de grossesse. Je saigne à chaque lune, du ventre trop et du cœur sans cesse. La douleur engendre ma colère et je crie souvent contre le vent qui me renvoie ma violence comme une gifle donnée à toute volée. Vaincue par ce combat inégal, je regarde, hébétée, la terre tourner (pp.11, 21) »…
En souvenir de deuil, les femmes du village ont habillé un couple d’épouvantails se tenant par la main : « depuis, notre village de femmes vit sous le regard de ce couple qui n’a jamais été et dont les deux silhouettes immobiles tournent le dos à la vallée. C’est notre signe pour dire qu’ici il y a la vie (p.13) ». Vidé de ses hommes, les femmes réorganisent le village, accomplissant les tâches jadis réservées à leurs feus compagnons. Même ainsi, alors que le conflit est loin, la situation n’est pas sans dangers : les commensaux indésirables sont une menace : « nous attendions les prédicateurs et les soldats de tout poil. Nous n’étions que femmes et enfants et nous savions que nous devrions nous défendre contre ces deux familles de prédateurs des faibles (p.11) »…
L’Homme, cet inconnu
Un jour, après deux ans de vie exclusivement féminine, un homme approche ; hormones et imaginations s’emballent : « nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d’une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s’arrêtent tous ensemble d’amonteiller le foin. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s’empoignent et nos doigts se serrent à en craquer les jointures : notre rêve est en marche, glaçant d’effroi et brûlant de désir. L’homme monte […] Tous nos sens sont tendus vers lui […] Et voici que la proximité de cet homme bouscule notre patience et transforme la bonne chienne qu’elle était, couchée à nos pieds, en une louve affamée (p.7) ». Et l’auteur, avec franchise, décrit sa mue avec sa soif animale : « nous avons tout prévu de la venue d’un homme. Notre premier objectif était sa semence, ensuite sa force de travail, enfin sa présence. Jamais son amour. Même en secret, je n’ai pas envisagé cette éventualité et mes compagnes non plus. Nous étions trop tendues vers ce besoin primaire, cet appel de vie qui nous vient de l’aube de l’humanité et même du monde des bêtes : la reproduction (p.15) »…
Et comme le sont généralement les femmes dans les situations difficiles, elles scellent un pacte, entre elles, qui sera scrupuleusement respecté pour le bien de toutes : « chaque soir, je vais lui faire son souper dans la maison où nous l’avons installé. C’est la règle que nous avions décidée entre femmes avant son arrivée : celle que l’homme toucherait en premier aurait la priorité. Elle s’occuperait de lui. Les autres se tiendrait à l’écart jusqu’à ce que la première en ait fait son homme. Alors celle-ci devrait lui faire comprendre qu’en devenant l’homme de l’une, il avait le devoir d’être également l’homme des autres, la semence du village (p.27) ». Violette règle vite son dilemme, lancinant et moral, entre elle et sa conscience : « je suis troublée d’avoir si vite oublié Martin. Cette trahison de mon cœur heurte ma raison. Elle me révolte et me bout en dedans, ce qui me rend brusque et souvent désagréable (p.30) »…
Mais la vie n’a que faire de la raison, en comme la raison des hommes fut seule cause de leurs malheurs antérieurs, la vie réclame maintenant son dû : « notre première rencontre physique va durer des heures. Jusqu’au matin il va me caresser et m’aimer de mille façons avant de me laisser pantelante et émerveillée. Au début, je me retiens de mordre à pleines dents dans cet homme que j’attends depuis longtemps, depuis toujours je crois. Je sais ma faim mais je ne sais pas ce qu’il faut faire. Je ne sais pas comment une femme doit être la première fois qu’elle va jusqu’à la peau de l’homme […] La nuit court ainsi pleine de pluie, de la faim de nos corps, de grands moments de tendresse et de caresses. C’est la vie qui pénètre la terre et mon corps. Je découvre le merveilleux outil que sont ses mains d’homme sur moi (pp.29-31) »…
Un opuscule qu’il conviendrait de mettre dans les mains de tous les hommes qui décident de l’avenir des autres, à commencer par les politiciens qui engagent leurs pays dans des conflits meurtriers… Ce qui me rappelle cet aphorisme récent : « when Clinton lied, nobody died », quant Clinton mentit, nul ne mourut…
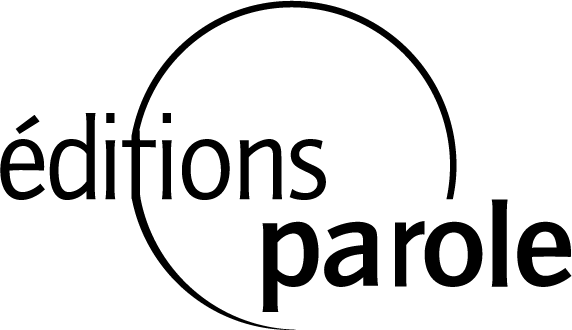
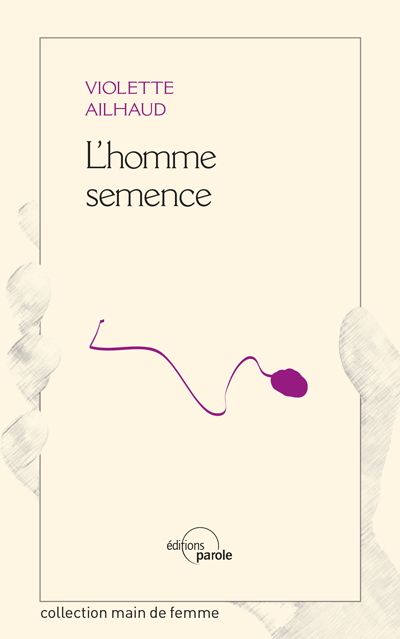
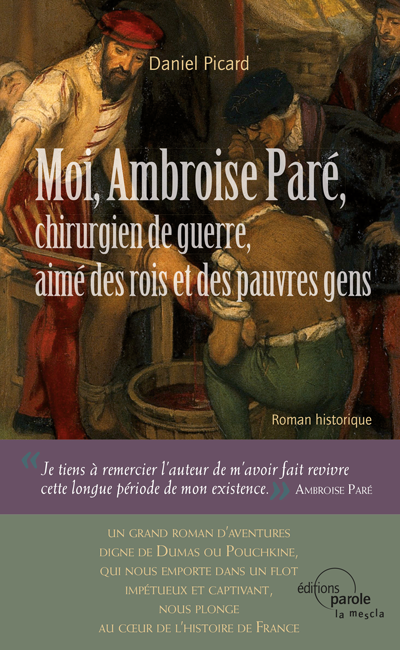
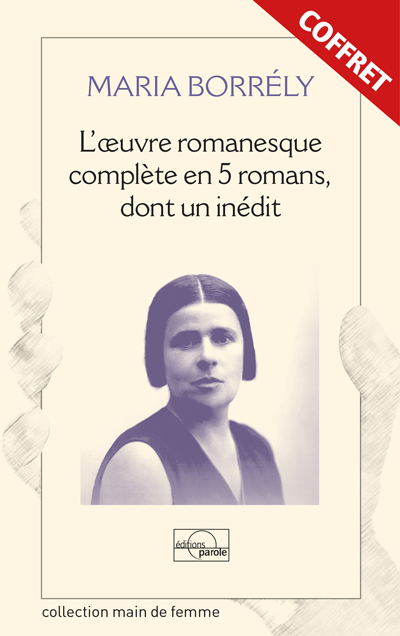
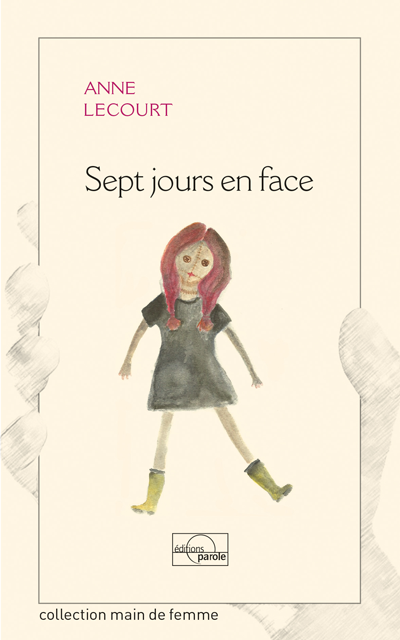
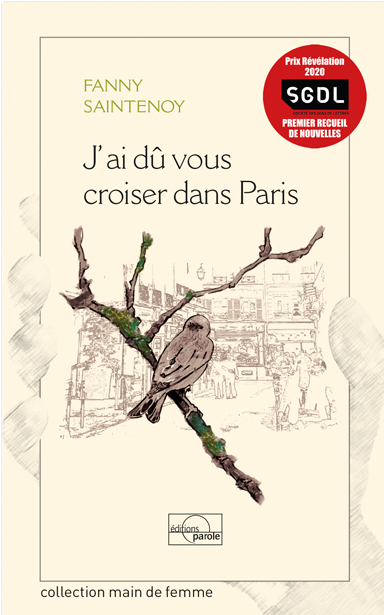
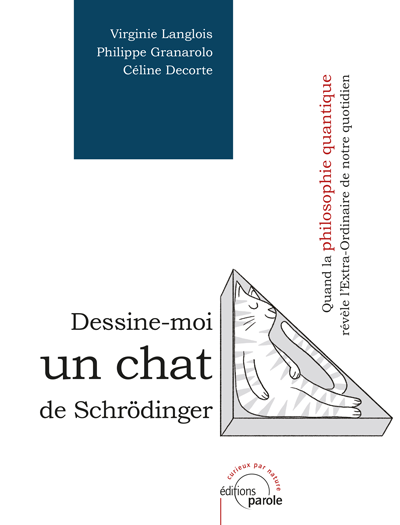
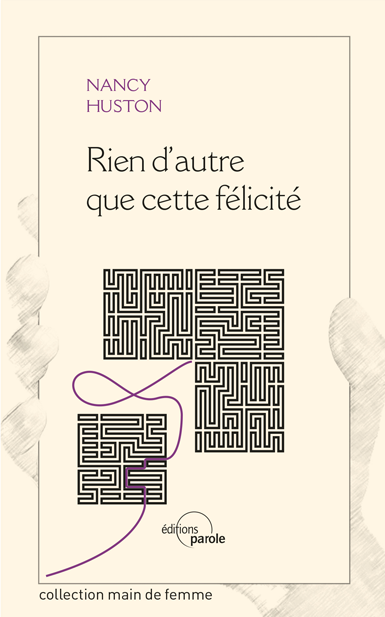
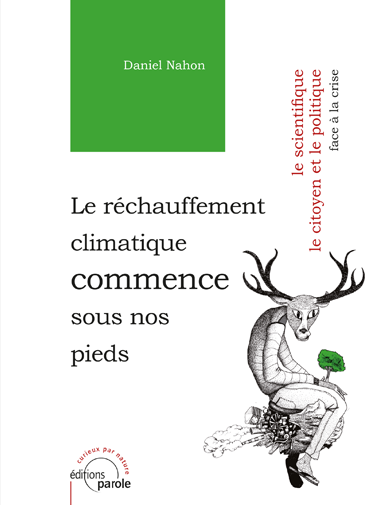

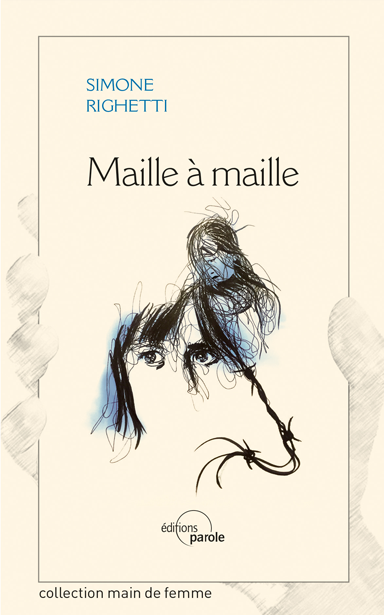
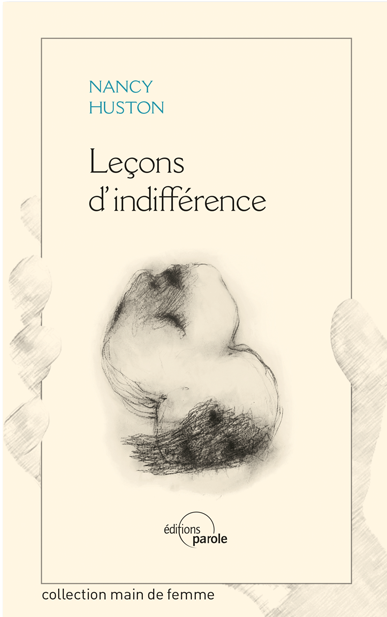
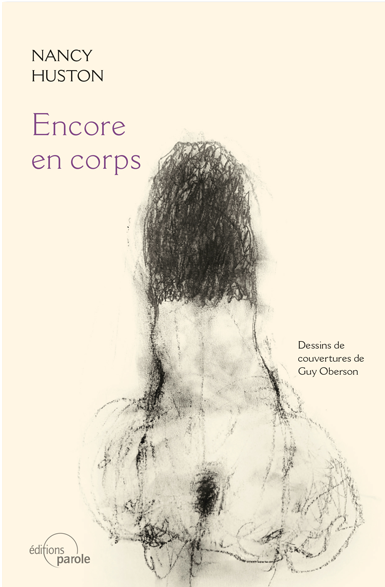
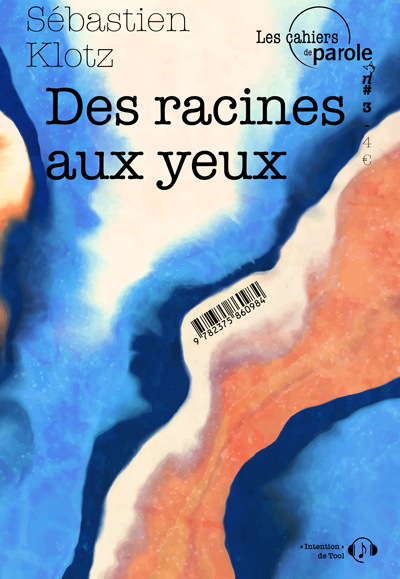
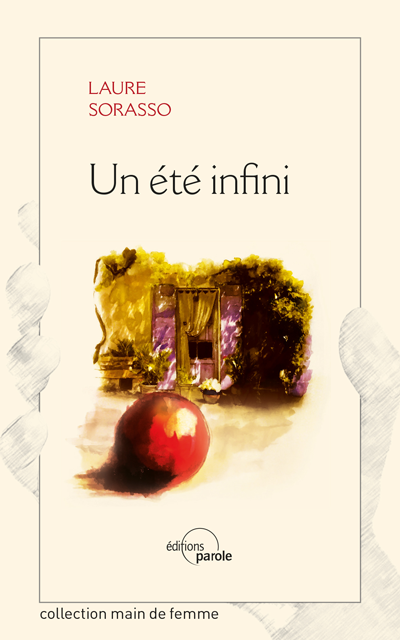
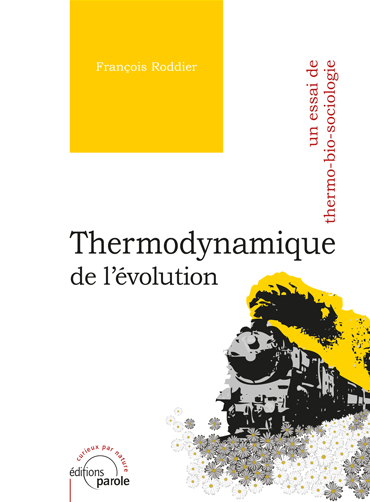
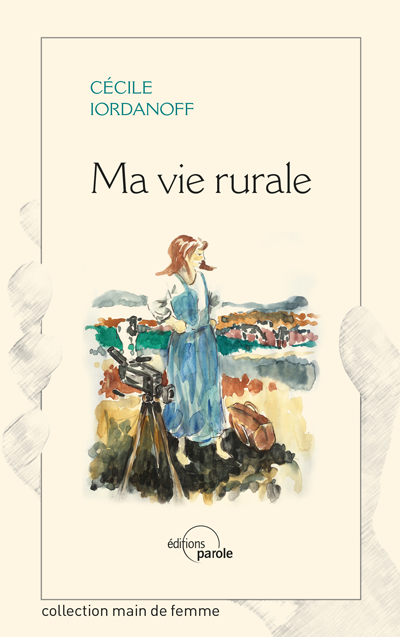
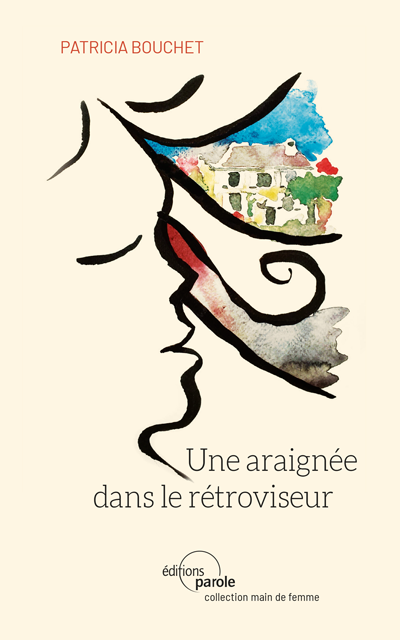
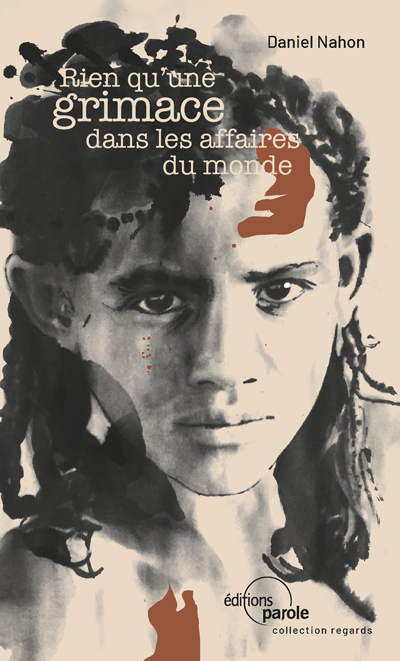
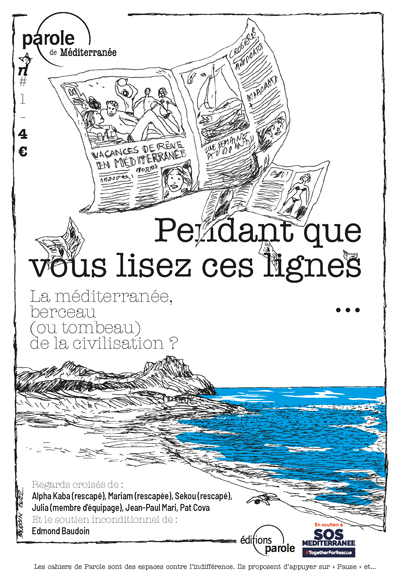
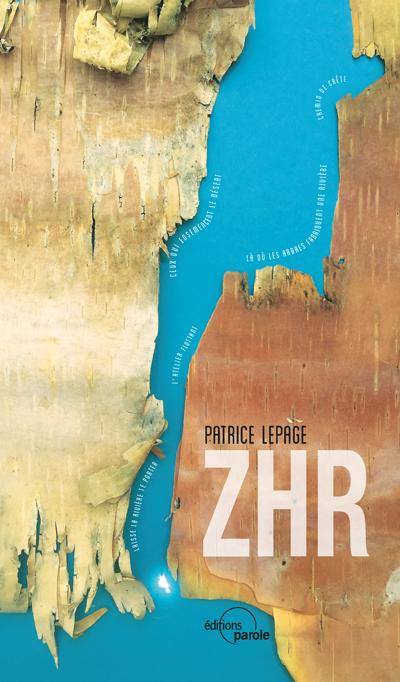

2 réponses
Quelle belle collection. De blog en site, je l’ai commandé et me fait une joie de le lire.
Récit-confession, récit-imagination, canular ? Quoiqu’il en soit, ce texte semble avoir été rédigé ou inspiré ou par une féministe des années 2010 – on pense par exemple à une imitatrice provençale de Xavière Gauthier, grande spécialiste, entre autres, des œuvres de Louise Michel – ou par une féministe du début du XXe siècle. On ne sait laquelle de ces deux hypothèses choisir, tant elles sont plausibles.
Que ce récit soit faux, basé sur un ou des rêves, ou en partie vrai, ne change rien à son « idéologie ». Il reprend en effet un fantasme « féminisant », particulièrement lourd de conséquences. C’est pourquoi ce texte a été repris et diffusé immédiatement, sans aucune distance critique, dans le cadre de loisirs populaires d’aujourd’hui comme le cinéma, le conte, la danse, la bande dessinée, comme s’il s’agissait d’un témoignage, d’un documentaire, d’un reportage : il « colle » parfaitement à certains préjugés contemporains très en vogue, qui ont refait surface depuis quelque temps et qui essayent de réduire l’homme et la femme à leurs « glandes », leurs « hormones », à leur côté biologique et animal.
Cet récit ne représente rien « d’universel », comme il est dit, et ne vient pas non plus « des profondeurs de l’histoire ». Même s’il fait allusion à des événements historiques, son « idéologie » est anti-historique, car elle repose sur le cliché populaire classique de l’origine des guerres – évidemment toujours fomentées par des hommes –, alors que la femme, elle, serait pacifique, biologiquement pacifique, et tournée « instinctivement » vers la vie et la reproduction de la vie.
On sait ce que Mussolini a érigé ce préjugé populaire en mot d’ordre fasciste : « la guerre est pour l’homme ce que la maternité est pour la femme ». Actuellement, cette idée reçue nous vient du « deep feminism » américain, qui est un dévoiement du féminisme. De nombreux historiens et historiennes, de même que les anthropologues, les philosophes ou les psychanalystes, ne cessent de montrer son inanité.
Contrairement à ce que croit Clarisse Young, il n’y a pas « d’instinct féminin » qui se manifesterait par le désir de se reproduire « face à la folie des hommes » : détruire leurs congénères, les supprimer en « inventant » des guerres. Cette affirmation hâtive est le résultat d’une lecture inattentive du texte et d’idées reçues qui empêchent de penser en toute liberté. Car le promis de Violette Ailhaud n’est pas parti à la guerre ; il a été victime d’une rafle napoléonienne et assassiné à la sortie du village. Il s’agit d’un crime perpétré dans le cadre d’un massacre.
Il est dit également qu’entre 15 et 30 ans, « une personne suit encore ses instincts », et n’est pas entièrement prisonnière des préjugés sociaux. Dans la réalité, c’est plutôt l’inverse que l’on observe le plus souvent. On est d’abord prisonnier des préjugés de sa famille, de son milieu social ; on s’en libère progressivement si l’on fait l’effort d’essayer d’accéder à la culture, comme l’explique longuement Rousseau au début du sixième livre de ses Confessions.
« Soif animale », « hormones et imaginations s’emballent», Clarisse Young s’emballe peut-être aussi un peu vite, mais il faut dire que l’auteur lui a fourni l’occasion d’enfourcher le stéréotype qui réduit la femme à une nature, à la biologie, à ses hormones, quand elle parle de : « ce besoin primaire, cet appel de vie qui nous vient de l’aube de l’humanité et même du monde des bêtes : la reproduction » (p. 17). Cette croyance est profondément anti-culturelle.
Le plus ordinaire des fantasmes de la littérature populaire féminisante, c’est de transformer le désir d’enfant en un besoin physiologique, comme la faim et la soif, qu’il serait impossible de ne pas assouvir. Il consiste à réduire la femme à un être biologique, sur le mode animal : une telle femme ne peut pas ne pas vouloir le mâle et le rechercher pour… se faire faire un enfant, non forcément pour trouver un amour. Cette idée anti-humaniste est évidemment très contestable. Elle jette une ombre négative sur ce beau récit et entrave la perception de la situation particulière qui y est évoquée.
Soyons vigilant. Posons-nous des questions et retrouvons un esprit d’analyse.